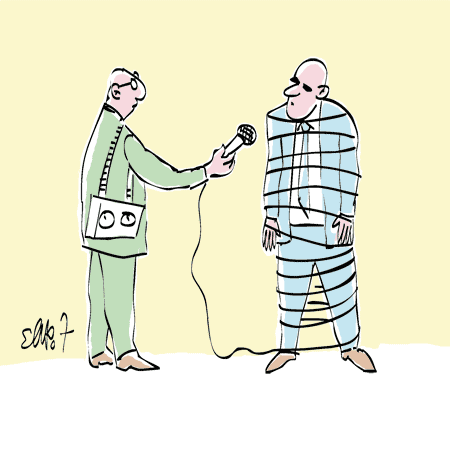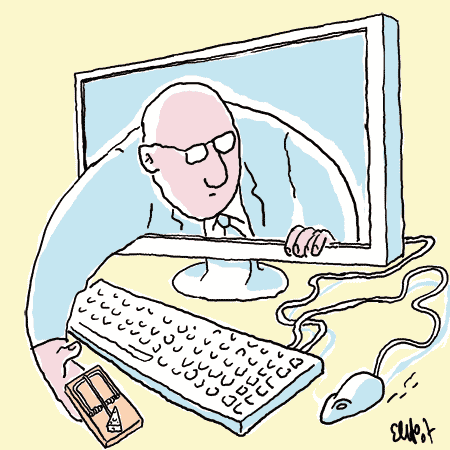Le bras qui ne repoussera pas…

Azwaw, c’est un peu la terreur des rédactions de journaux. C’est aussi un peu la mauvaise conscience de toute cette presse née dans la tourmente de la révolution d’octobre. Il sait que c’est un peu grâce à lui que cette presse existe. Au fond de lui, même s’il ne le conceptualise pas de cette manière, même s’il ne le dit pas, il sait que cette presse lui appartient quelque part, il en est d’ailleurs un des «actionnaires» légitimes même s’il ne touche pas les dividendes en fin d’année et que son nom n’est pas en bas des pages des statuts notariés. Mais qu’importe les notaires et tous les ronds-de-cuir.
Cette presse lui appartient, parce qu’il en a été un des instigateurs malgré lui, avec tous les autres gamins sortis en 1988 dans la rue affronter les chars de l’armée… même si depuis, disons-le avec toute l’humilité qui y sied, les objectifs éditoriaux des débuts ont été déroutés vers des chemins de traverses où l’équivoque le dispute souvent à l’ambiguïté. Des objectifs parfois moins glorieux que ceux pour lesquels cette presse est née dans la douleur d’une césarienne et pour lesquels Azwaw a perdu un bras. Il avait 21 ans en 1988. Le bel âge. Mais le bel âge abdique devant la puissance de feu d’une arme de guerre. C’était à Bab El Oued. Une fusillade. Une panique. Des balles en trop et un bras en moins.
Azwaw à le côté agaçant des coureurs de fond. C’est qu’il a du souffle le grand gaillard ! Ce dont nous manquons tristement dans cette profession.
Azwaw, vous êtes sûr de le voir arriver taper aux portes des rédactions quelques jours avant chaque célébration du 5 octobre. Il prend un congé spécial. Et se consacre à sa tâche avec la rigueur d’un ascète. Il est là à vous guetter à l’entrée des bureaux pour vous rappeler à l’ordre mémoriel. C’est un peu comme un scripte sur un plateau de cinéma. Sauf que lui n’est pas la mémoire d’un film. Il est la mémoire d’une tragédie. Et cette mémoire, il ne la porte pas dans un cahier mais dans sa chair. Son corps. Vous pouvez le rabrouer allègrement, il ne s’en offusquera pas et rappliquera avec la même opiniâtreté adoubée d’un sourire en coin qui lui donne un côté enfantin malgré la robustesse de ses 40 ans. Azwaw a la force des arbres centenaires qui résistent aux vents et aux bourrasques des pantalonnades.
Azwaw aura vécu une moitié de vie avec un bras en moins. Depuis octobre 88. Bientôt 20 ans. Il est marié. Il a des enfants. Il travaille. Il conduit. Il ne se laisse pas abattre et refuse de sombrer dans le culte de la victimisation. Il ne cherche pas de logement, un lot de terrain, un local pour ouvrir un commerce ni même une licence de taxi. C’est ce qui le rend admirable. Il cherche à vivre dans la vérité. Un statut. 20 ans après, Azwaw, et c’est scandaleux, avec toutes les autres victimes des événements d’octobre, sont considérés comme victimes d’accidents de travail. Pas victime de la répression. Il est temps que l’Etat se débarrasse de ses mensonges et reconnaisse ces victimes comme celles de la répression. 20 ans à revendiquer un statut. 20 ans à nous rappeler Octobre. 20 ans à tenter d’être autre chose qu’un accidenté de travail. 20 ans à lutter pour que l’Etat reconnaisse les faits. C’est tout.
Aujourd’hui le bonheur d’Azwaw, c’est sa petite fille, la toute dernière. Il dit qu’elle aime manger les fruits sur les tartes mais qu’elle laisse la pâte feuilletée intacte.
Il raconte sa fille et me demande de dire quelques mots pour octobre de cette année. Quelques lignes de plus.
Et que dire du 5 octobre encore une fois ? Rien. Parce qu’il n’y a rien de plus cruel qu’un rêve qui se transforme en une coutumière célébration.
Azwaw continue inlassablement son combat. Il a un coffre dans lequel il a mis de la documentation. Des articles de presse concernant cette période. Des coupures de presse, nationale et internationale, qu’un ami journaliste lui a offertes. C’est tout ce qu’il lui reste de cette période. Des articles de presse…
Ce coffre, je l’ai caché au bled. Au village de mon père, en Kabylie, pas ici…jamais ! Les coupures sont dans un coffre qui a servi à prendre les affaires de ma femme lors de notre mariage. Je l’ai confisqué pour la bonne cause», s’amuse-t-il à dire.
Son coffre, il ne le garde pas chez lui, à Alger. Quand je lui demande pourquoi, il me dit qu’à Alger, il a toujours peur d’un tremblement de terre. Il a peur de tout perdre. Il a alors choisi, pense-t-il, une zone antisismique.
Sa fille lui demande régulièrement où est le reste de son bras. Pourquoi il ne sort pas ? Pourquoi il ne grandit pas ? Ça l’intrigue. Forcément. Pour elle, le moignon de son papa, c’est un bébé.
Elle pense que ce bras va grandir un jour comme elle et devenir entier. Elle embrasse souvent ce bras amputé. Son petit bébé à elle. Elle attend que le bras de son papa pousse. Azwaw sait que ce bras ne repoussera pas. Il se dit alors que si je n’ai pas pu sauver mon bras, je pourrai peut-être sauver quelques bribes d’histoires qu’il met dans ce coffre où il cache précieusement ses coupures de presse. Un coffre qu’il n’oublie jamais de fermer à clef. Un coffre dans lequel il met soigneusement, chaque année, du camphre pour éviter les moisissures et les termites de l’histoire.